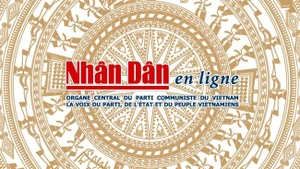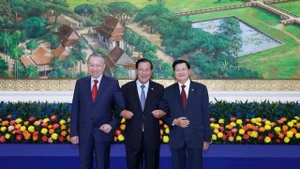L’événement s’annonce décisif, dans un contexte où la lutte mondiale contre le réchauffement climatique semble menacer de perdre son cap. En prélude à la conférence, un Sommet sur le climat réunira, les 6 et 7 novembre à Belém, des dirigeants de 143 pays afin de donner un nouvel élan aux négociations de la COP30.
Des défis majeurs
Dans son dernier rapport publié à la veille de la COP30, l’Organisation météorologique mondiale (OMM) des Nations unies indique que la concentration de dioxyde de carbone (CO2) dans l’atmosphère a atteint un niveau record en 2024, avec l’augmentation la plus rapide depuis le début des mesures en 1957.
Selon l’OMM, la progression mondiale du CO₂ entre 2023 et 2024 est la plus élevée jamais enregistrée. L’organisation met en garde que la chaleur piégée par le CO₂ et d’autres gaz à effet de serre accélère le changement climatique, contribuant à la multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes observés dans le monde ces dernières années.
Les chiffres publiés par l’OMM révèlent que la lutte mondiale contre le changement climatique reste confrontée à d’importants défis. Outre des émissions de gaz à effet de serre à des niveaux record, les engagements climatiques des pays sont également remis en question.
Lors du Sommet sur le climat, tenu fin septembre à New York dans le cadre de la 80ᵉ session de l’Assemblée générale de l’ONU, l’ONU a indiqué que seulement une cinquantaine de pays avaient soumis leur nouvelle «Contribution déterminée au niveau national» (NDC), qui précise leurs engagements pour les cinq prochaines années.
Le financement climatique demeure un défi majeur. Selon le «Rapport sur la réduction de l’écart d’adaptation» publié le 29 octobre par le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), les contributions financières des pays développés pour aider les pays en développement à s’adapter au changement climatique ont diminué, passant de 28 milliards de dollars en 2022 à 26 milliards de dollars en 2023.
Pourtant, le PNUE estime que les pays en développement ont besoin de 310 à 365 milliards de dollars par an rien que pour leurs projets d’adaptation. Ce montant serait encore plus élevé si l’on prend en compte d’autres actions climatiques, comme la réduction des émissions ou la transition énergétique.
Selon l’accord conclu lors de la COP29 l’an dernier à Bakou (Azerbaïdjan), les pays riches se sont engagés à verser 300 milliards de dollars par an pour le financement climatique à partir de 2035. Or, les recherches de l’ONU montrent que les seuls pays en développement ont besoin d’au moins quatre fois ce montant.
«La science est sans équivoque: nous devons viser beaucoup plus haut. Au Brésil, les dirigeants doivent mettre en place un plan crédible pour mobiliser 1.300 milliards de dollars par an d’ici 2035 afin de financer les actions climatiques dans les pays en développement», a souligné le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres.
Afin de concrétiser cette ambition lors de la COP30, un groupe de 35 ministres des Finances a présenté, le 15 octobre dernier, une série de propositions visant à porter le financement climatique mondial à 1.300 milliards de dollars par an.
Dans leur rapport publié le même jour, les ministres, menés par le Brésil, appellent à réformer plusieurs domaines, notamment la notation de crédit, les taux d’assurance et les priorités de prêt des banques de développement, afin de mobiliser davantage de ressources pour la lutte contre le changement climatique.

Des interrogations autour de la politique des États-Unis
Les récentes orientations politiques de certains pays font naître des inquiétudes quant à la cohérence des efforts mondiaux de lutte contre le changement climatique, notamment aux États-Unis, deuxième plus grand émetteur de gaz à effet de serre de la planète.
Dès son retour à la Maison-Blanche en début d’année, le président Donald Trump a annoncé le retrait des États-Unis de l’Accord de Paris de 2015 et n’a cessé de critiquer les initiatives climatiques internationales. Sur le plan intérieur, il a également réduit de nombreuses mesures de soutien en faveur des industries vertes.
Selon les observateurs, le retrait des États-Unis de leurs engagements climatiques risque d’avoir un impact négatif sur les efforts mondiaux, le pays jouant un rôle clé en tant que première économie mondiale dans la promotion des Contributions déterminées au niveau national (NDC) des autres nations et dans la transition énergétique à grande échelle.
Cependant, le professeur David J. Hayes, de la Doerr School de l’Université Stanford (États-Unis), estime que les États-Unis font actuellement face à une pénurie d’électricité pour soutenir le développement de l’intelligence artificielle (IA) et la construction de vastes centres de données.
À long terme, les grandes entreprises américaines seront donc contraintes d’accélérer la production d’énergies propres — solaire et éolienne — devenues aujourd’hui moins coûteuses et plus fiables que les combustibles fossiles.
Ainsi, bien que les politiques climatiques de l’administration Trump puissent avoir certains effets, elles ne devraient pas parvenir à inverser la tendance mondiale vers la transition verte.
«Les politiques de Donald Trump risquent bien de provoquer un effet boomerang, en soulignant plus que jamais l’importance des énergies sans carbone. C’est une dynamique historique: elle s’impose, elle est déjà en marche et progresse avec force, malgré les tentatives de freiner les investissements dans les énergies propres. Je suis convaincu que ces investissements doubleront dès que l’occasion se présentera», déclare David J. Hayes.
Autre signe encourageant: les grandes puissances économiques continuent d’afficher leur détermination à agir pour le climat. Fin octobre, l’Union européenne a adopté un nouvel objectif ambitieux de réduire de 90% ses émissions de carbone d’ici 2040, soit bien avant le calendrier initialement prévu.
De son côté, la Chine – premier émetteur mondial et deuxième économie de la planète – réaffirme, dans son tout nouveau plan quinquennal, sa volonté de poursuivre une stratégie axée sur l’industrie verte et le développement durable.
Certes, la feuille de route pour la sortie des énergies fossiles, proposée lors de la COP28 à Dubaï en 2023, reste à préciser. Mais, sur le terrain, les énergies renouvelables explosent.
Selon l’organisation de conseil internationale Ember, durant le premier semestre 2025, elles ont pour la première fois dépassé le charbon pour devenir la première source d’électricité au monde.