Dans un contexte de changement climatique global sévère, le crédit carbone s’impose comme un instrument financier majeur pour accélérer la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Avec une valeur marchande mondiale estimée à plusieurs centaines de milliards de dollars d’ici 2050, le crédit carbone n’est plus seulement un indicateur environnemental, mais devient un moteur de développement économique durable.
Le crédit carbone, en voie de devenir une « monnaie »
Le crédit carbone, ou certificat carbone, est un instrument essentiel pour mesurer et gérer les gaz à effet de serre (GES) évités, réduits ou éliminés, équivalant à une tonne de CO₂ retirée de l’atmosphère.
Considéré comme une sorte de « permis » de droit d’émettre des GES, il n’est toutefois attribué qu’aux projets capables de démontrer une réduction des émissions excédant la situation de référence, ce que l’on appelle l’« additionnalité ».
Selon l’Institut de la finance d’entreprise, ce titre peut être acheté ou vendu : son détenteur peut compenser ses émissions en finançant des projets de réduction de CO₂, contribuant ainsi à freiner le réchauffement climatique.
Ce concept est apparu dès le protocole de Kyoto de 1997 et s’est renforcé avec l’Accord de Paris en 2015, qui ont tous deux encouragé l’usage des crédits carbone comme instrument de compensation par le marché, en soutenant des programmes de reforestation, d’énergies renouvelables ou de technologies propres.
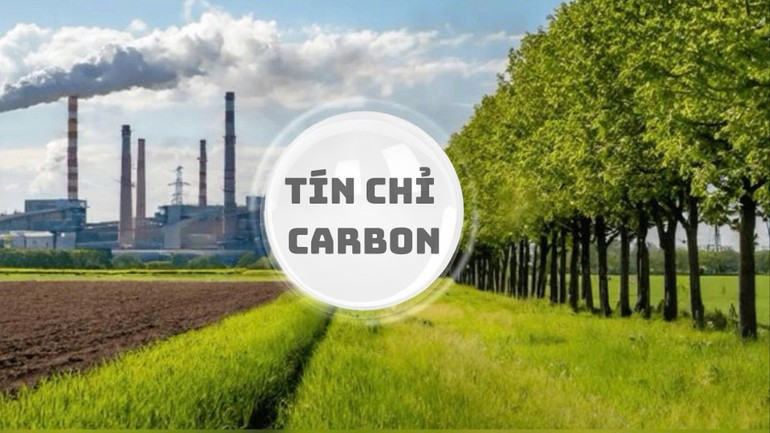
Selon Betty Pallard, directrice Vision chez ESGs & Climate Consulting : « Le crédit carbone tend à devenir une monnaie, un produit financier dérivé au carrefour de domaines rarement associés : la nature, la finance, les actifs fonciers, jusqu’à la connaissance et les données. »
Les crédits se déclinent en trois catégories : blanc (technologies de capture de CO₂), vert (forêts, végétation) et bleu (eau), chacune ciblant un objectif spécifique.
« Il ne s’agit pas de simples transactions de crédits classiques, mais d’un investissement collectif dans des projets générateurs de crédits carbone, c’est analogue à une obligation », précise-t-elle.
Néanmoins, le marché doit surmonter des défis majeurs, notamment le manque de transparence et le risque de greenwashing, imposant des critères internationaux rigoureux.
La dynamique mondiale du marché du crédit carbone
Face à l’urgence climatique, le marché du carbone devient un instrument clé de réduction des émissions de GES.
Selon certaines estimations (par Refinitiv), le marché atteignait 1 500 milliards de dollars en 2024 (soit environ 15,7 milliards par an), avec une expansion attendue en 2025 portée par les engagements de la COP29 et les mécanismes européens, comme le CBAM.
D’après l’Institute for Carbon Markets, environ 73 régimes d’échange de crédits, volontaires ou obligatoires, couvrent près de 23 % des émissions mondiales, générant près de 100 milliards de dollars en 2022, dont 98 %, à travers les programmes contraignants.

En Europe, le système d’échange des quotas d’émission (ETS) est exemplaire : ses crédits s’échangent entre 80 et 100 dollars la tonne grâce à une régulation stricte et une donnée transparente. En Chine, le programme CCER devrait être relancé en 2025. En République de Corée, la participation volontaire des entreprises est encouragée. Toutefois, des catastrophes naturelles, comme les incendies et inondations au Canada, peuvent entraîner la disparition soudaine des crédits, soulignant des risques de volatilité et d’inégalités selon la fiabilité des données.
Perspectives pour le Vietnam
Le Vietnam s’engage activement dans les efforts mondiaux, visant à limiter le réchauffement à 2 °C selon l’accord de Paris, avec une réduction de 28 % des émissions d’ici 2030.
Avec près de 14,7 millions d’hectares de forêts, le pays pourrait absorber jusqu’à 70 millions de tonnes de carbone par an. En partenariat avec la Banque mondiale, il a généré 10,3 millions de tonnes de crédits carbone dans le nord-centre, recevant 51,5 millions de dollars de financement.
Des négociations avec l’initiative LEAF visent à étendre ces projets dans le Tay Nguyen et le sud‑centre, mobilisant les ressources forestières pour créer de la valeur économique tout en protégeant l’environnement.
Le double marché, obligatoire et volontaire, ouvre des opportunités financières substantielles, à condition d’adopter rapidement un cadre législatif stimulant les projets forestiers.

Mme Pallard conclut : « Le Vietnam dispose d’un avantage considérable sur la scène carbone mondiale. Les Vietnamiens excellent en mathématiques, un atout essentiel pour mesurer et certifier les crédits carbone. Par ailleurs, notre proximité historique avec la nature nous offre un savoir-faire que d’autres doivent encore acquérir ».
Avec une économie agricole dominée à 92 % par des PME, le Vietnam peut établir un modèle de marché adapté, intégrant la restauration des sols dans son ambition de neutralité carbone.
Elle insiste : « Le jeu des crédits carbone est un jeu dans lequel le Vietnam peut jouer un rôle majeur », d’autant que les émissions par habitant sont faibles (3,6 tonnes/an, contre 17–18 tonnes aux États-Unis ou 9 tonnes en Europe), renforçant sa position stratégique dans le secteur agroforestier.















