La directive rappelle que la médecine traditionnelle vietnamienne constitue un « patrimoine culturel précieux de la nation », façonné au fil de l’histoire. Sa préservation et son évolution sont présentées à la fois comme une responsabilité politique et comme une mission culturelle, tout en répondant aux besoins de santé publique dans un contexte en mutation.
Entre progrès notables et fragilités persistantes
Ces dernières années, le secteur a connu des avancées significatives : modernisation des infrastructures de soins, consolidation du réseau de médecine traditionnelle dans les centres de santé de proximité, diversification et amélioration des services thérapeutiques.
Mais les autorités reconnaissent aussi des limites : un potentiel encore sous-exploité, une visibilité insuffisante dans le développement socioéconomique national, et un risque de retard par rapport à d’autres pays asiatiques disposant d’écoles de médecine traditionnelle influentes.
Pour y remédier, le gouvernement fixe des objectifs ambitieux à l’horizon 2030 : clarification des responsabilités des institutions publiques, intensification du contrôle et du suivi des programmes, mise en œuvre coordonnée des politiques déjà adoptées, et intégration renforcée de la médecine traditionnelle dans le système de santé.
Des chantiers structurants
Le ministère de la Santé est chargé de réviser le cadre juridique afin de mieux intégrer les spécificités de la médecine traditionnelle et d’envisager la création d’une loi dédiée. L’extension de la prise en charge par l’assurance maladie des traitements, plantes médicinales et services liés est également à l’étude.
Parallèlement, le gouvernement souhaite développer les infrastructures avec la construction et la modernisation d’hôpitaux spécialisés, encourager l’intégration des techniques traditionnelles (acupuncture, soins non médicamenteux) avec la médecine moderne, et renforcer la recherche clinique sur les pharmacopées locales.
Une attention particulière est accordée à la préservation des ressources végétales : élaboration de cartes nationales et locales des zones de culture, conservation des espèces rares, standardisation des processus de culture, récolte et transformation selon les normes internationales (GACP-WHO, certifications biologiques). Le tout devant être appuyé par des outils numériques pour assurer la traçabilité et la transparence de la chaîne de production.
Formation, coopération internationale et tourisme médical
La directive met aussi l’accent sur la formation de ressources humaines qualifiées et sur la numérisation des savoirs traditionnels (archives, herbiers, biographies de praticiens, corpus scientifiques). Le Vietnam entend accroître sa coopération avec des pays disposant d’une tradition forte dans ce domaine, comme la Chine, la République de Corée ou l’Inde, et participer activement aux échanges multilatéraux.
Enfin, les ministères du Commerce et du Tourisme sont invités à promouvoir la médecine traditionnelle comme un atout culturel et économique : soutien aux entreprises d’exportation, régulations de la publicité, et développements de formes de « tourisme médical » associant soins de santé et découverte culturelle.
Un objectif : un hôpital moderne de médecine traditionnelle par province
Les collectivités locales devront consacrer une partie de leur budget au secteur et favoriser l’investissement privé. Le gouvernement fixe un objectif symbolique : chaque province devrait disposer, d’ici 2030, d’au moins un hôpital moderne combinant médecine traditionnelle et médecine moderne.
À travers cette directive, Hanoi cherche à transformer la médecine traditionnelle en un pilier à la fois sanitaire, scientifique et économique, tout en en faisant un vecteur de rayonnement culturel à l’international.



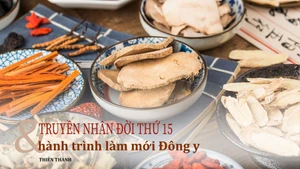



![[Photos] Réveillon du Nouvel An à bord du « Train du Bonheur » : un voyage de partage et de retrouvailles](https://fr-cdn.nhandan.vn/images/6fc9a91d62b03efcc5b1d8a44d9ed4978ed0fbd57b21b3cc689da517ed6e1e85501b3e29222a2b120918f9e95d97885f43009815eb39ef8c6c006b30c1dafbbf/tau-1.jpg.webp)








