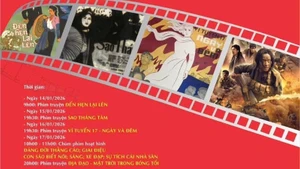Pour les femmes Dao, chaque point de broderie, chaque nuance d’indigo est une manière de préserver l’identité de leur peuple.
Pour préparer le rite d’initiation marquant la majorité d’un jeune homme Dao, Dang Thi Hoa s’y est prise trois ans à l’avance.
Le jour dit, son fils revêt une tenue neuve aux motifs éclatants, symbole de maturité et de respect des ancêtres. La mère a teint elle-même le tissu à l’indigo, avant de broder avec soin des motifs rouges et blancs représentant la nature et des animaux familiers.
Quelques pièces d’argent cousues sur le vêtement expriment des vœux de bonheur et de prospérité. Il faut savoir que cette tenue n’est portée qu’une seule fois dans la vie.
«Notre peuple n’abandonnera jamais ses traditions. Une femme Dao doit savoir broder. Cette veste, je l’ai teinte à l’indigo avant de la broder, et il m’a fallu trois ans pour la finir. Les motifs doivent être ceux que brodaient nos ancêtres, ils portent l’âme de notre peuple», nous confie Dang Thi Hoa.

Chez les Dao, le parfum de l’indigo est indissociable du vêtement traditionnel. Jadis, les femmes cultivaient le coton et tissaient elles-mêmes leur tissu. Aujourd’hui, si elles ne filent plus, elles continuent de teindre. Il existe deux méthodes de teinture principales.
Selon la première méthode, les feuilles d’indigotier, fermentées avec de la cendre pendant 4 ou 5 jours puis mélangées à de la chaux, produisent une teinture épaisse dans laquelle le tissu est plongé plusieurs fois jusqu’à obtenir la nuance désirée. L’autre méthode consiste à cuire les feuilles.
Quelle que soit la méthode, le tissu est teint plusieurs fois, séché, trempé, séché… et ainsi de suite. Ce procédé répétitif confère au tissu une chaleur naturelle, précieuse dans le climat froid des montagnes, explique Triêu Thi Hoa, une autochtone.
«Autrefois, on passait un mois entier à teindre un vêtement. Ce n’est qu’une fois le tissu imprégné de l’odeur de l’indigo que l’on pouvait commencer à broder», raconte-t-elle.
Dès l’âge de dix ans, les filles apprennent à broder auprès de leur mère. En grandissant, elles confectionnent leur trousseau de mariage, puis les vêtements de toute la famille, preuve de leur habileté et de leur sens du devoir. À un âge plus avancé, elles préparent leur propre vêtement funéraire. Les motifs y sont plus simples, mais toujours imprégnés d’indigo, afin que les ancêtres puissent les reconnaître dans l’au-delà.

Dang Thi Vinh a atteint l’âge de procéder à cette coutume. «Quand j’avais une bonne vue, je brodais pour mes enfants. Maintenant que mes yeux sont fatigués, je fais pour moi-même. Ce n’est plus pour me faire belle, mais pour avoir un vêtement à porter quand je partirai», partage -t-elle.
Les motifs traditionnels représentent des oiseaux, des chiens, des singes ou des moutons. Les foulards sont décorés d’oiseaux et de franges rouges agrémentées de perles vertes. Les jupes, elles, sont souvent dessinées à la cire d’abeille. Après leurs travaux des champs, les femmes Dao reprennent l’aiguille. Leurs mains tannées par le soleil créent des motifs éclatants de rouge, de blanc, de jaune et de vert.
Autrefois portés au quotidien, ces vêtements traditionnels ne le sont plus aujourd’hui que lors des cérémonies ou des fêtes culturelles, nous dit Ly Thi Anh, une autre autochtone.
«Ces habits expriment notre identité. On les porte pour les rituels ou les spectacles culturels. Les jeunes les mettent rarement, mais nous, les femmes, devons montrer notre savoir-faire. Même fatiguées après le travail, on brode pour nos enfants, pour nos parents», explique-t-elle.
Chaque point, chaque nuance d’indigo, chaque motif est un fragment d’amour et de patience. Dans le souffle du temps moderne, les tenues des femmes Dao demeurent un symbole de fierté, un art qui relie les générations et fait vivre l’âme de ce peuple.